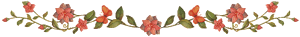
"Le silence est Quelqu'un que l'on regarde, en qui l'on vit,
Quelqu'un que l'on respire
et dont la présence suscite continuellement l'émerveillement et le respect"
Maurice Zundel
|
"Au fond d'une étroite vallée, charmante par ses eaux et ses ombrages, dans une paisible et
mystérieuse retraite qu'entourent des landes et des bruyères [...] fut construit un prieuré,
sous le vocable de Saint-Jean. [...] De toutes les constructions élevées alors, la chapelle
seulement [avec le logis des prieurs] subsiste aujourd'hui. Sa construction et
les souvenirs que son aspect fait naître, invitent à visiter ses ruines."
³
"Son origine se rattache à ces siècles de désordre et de confusion où deviennent
inexplicables ces sentiments de foi, de générosité et ces grands caractères qu'on y admire
souvent.
Des espèces de vagabonds, sous le nom de chevaliers errants, parcouraient surtout le midi
de la France, pillant les habitations, détroussant les voyageurs, et jetant partout sur leur
passage l'épouvante et le deuil. [...]
L'église de Merlande fut jetée dans ce désert comme une sauvegarde et un refuge."
²

|
"Là existe, depuis plus de huit siècles, une chapelle solitaire, dont le nom, formé de
deux mots celtiques, mer lande, signifie, suivant Bullet, une
vaste solitude."
¹
"Arrivé auprès de cette remarquable église, qu'on aperçoit pour ainsi dire que lorsqu'on est
au pied de ses murs, une foule de questions viennent assaillir l'esprit sur le but qu'on
pouvait se proposer en fondant cet édifice. La fontaine qu'on y aperçoit, et dont les eaux
limpides s'échappent en sillonnant la vallée, fut-elle le motif de cette création ? [...]
Les fondateurs de cette église n'auraient-ils voulu que rendre moins dangereux ce lieu désert
et offrir aux passants plus de sécurité, par la présence d'un édifice religieux ? "
¹
|
|
"En vain chercherait-on quelques sculptures sur le plein des murailles extérieures ; Il
n'en existe quelques-unes que dans les modillons de la corniche du sanctuaire.
Ces espèces de consoles représentent des têtes grotesques d'hommes et d'animaux. Sur l'une
d'elles on remarque un oiseau semblable à un coq ; il est parfaitement sculpté. Il n'est
pas douteux que cet oiseau soit un basilic, symbole religieux assez souvent employé
dans les constructions de cette époque. Cet animal était regardé comme puissant et très
redoutable. Super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis.
Psaume 90."
¹
|
CÔTÉ NORD
| |
| |
On remarquera la disparition du modillon, à droite sur la seconde la photo.
"Ce qui m'a consterné, c'est la disparition du mignon petit diablotin qui a été arraché
en haut du montant gauche de l'entrée du domaine, ce que ces messieurs les archéologues
appellent les monstres-léoniens ; mais celui en question était loin d'être un monstre mais
il avait un sourire ironique et était d'une grande finesse d'exécution. Il était admirable"
4
|
|
"Sur une des archivoltes [de la porte d'entrée du prieuré] fut gravé le mot PAX,
encore lisible aujourd'hui, indiquant qu'en cet asile on goûtait, dans le recueillement,
la prière et l'étude, la paix de Dieu que le monde chrétien devait vivement désirer en
ces temps de désordre."
³
|

|
|
"Dans ces temps de désordre et depuis le VIème siècle dans lequel Saint Benoît donna
sa règle, les ordres religieux firent un bien considérable aux classes inférieures de la
société occidentale. Enseignant et pratiquant la charité, possédant seuls la science, ils
attiraient autour des centres qu'ils avaient créées la plus grande partie des populations des
campagnes, qui, là, trouvaient une protection morale beaucoup plus efficace que celle accordée
par les batailleurs de cette funeste époque. Le pauvre venait à l'abbaye, et vers lui les
bras se tendaient. Sa misère était soulagée, du travail lui était donné.
Les évêques, les seigneurs laïques, de simples particuliers, firent des dons considérables
à ces établissements ; aussi dès le XIème siècle, possédaient-ils une grande partie du sol,
qu'ils défrichaient et cultivaient. Ce fut là une de leurs gloires, qui plus tard fut trop
vite oubliée."
³
|
|
"En entrant dans l'église de Merlande, on éprouve involontairement un sentiment de respect
mêlé d'admiration. On s'arrête dès le premier pas, surpris de trouver dans cette solitude
une église qui, par le caractère de son style, rappelant les générations les plus reculées,
contraste singulièrement avec l'isolement et l'abandon dans lesquels elle se trouve aujourd'hui."
¹
En 1846 effectivement, la chapelle était très abîmée, prête à s'effondrer, et les alentours,
en ruine...
|

|
|
"Le baptistère, de forme cylindrique, et semblalble à un fût de colonne, est très curieux. Il
est bien étonnant qu'il ait échappé aux mutilations si communes dans toutes les églises, d'où
l'on bannit tout ce qui est ancien pour y substituer des choses modernes, dans la pensée que les
goûts populaires en seront bien flattés. Les sculptures de ce petit monument représentent
une série d'anneaux losangés, s'enchaînant les uns dans les autres et occupant toute la
surface. Il est sans base et sans corniche, tel qu'il sortit des mains de l'ouvrier, pour la
destination qu'il a perdue à l'époque de la suppression de l'église de Merlande. En le
conservant soigneusement, il viendra sans doute une époque où son utilité pourra de nouveau
être appréciée."
¹
|

|
Ce "petit monument" aurait donc disparu pour être remplacé par deux autres, assurément anciens,
mais dont la provenance reste à découvrir...
À l'angle opposé, une porte murée... Ce n'est certes pas la trace de l'antique
"porte des morts", puisqu'elle ouvrait au sud, sur l'ancien cloître...
|

| |
"J'ai vu aussi la remarquable boiserie qui entourait les fonts baptismaux monobloc, présumés
du VIIIème ou IXème siècle, dans lesquels le candidat au baptême entrait en entier !
Toutes ces boiseries existaient encore en 1955, démontées. Les boiseries entourant le
baptistère étaient splendides, panneaux moulurés romans, piliers tournés sculptés ainsi
que les barreaux, tous sculptés."
4
|
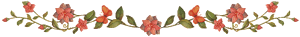
"Une nef, un chœur et un sanctuaire, telle est l'ordonnance de cette petite église.
Deux travées de voûtes séparées par un arc-doubleau, reposant sur deux colonnes, composent la nef
et le chœur. La première travée offre une voûte cylindrique ; la seconde en présente une
de sphérique."
¹
|
"Vers 1120, quelques religieux s'établirent à Chancelade (fons cancellatus) et y
fondèrent une abbaye dont l'importance alla toujours croissant, grâce aux dons généreux des
évêques de Périgueux, Guillaume d'Auberoche (1099-1130), Guillaume de Nanclars
(1130-1138) et Geoffroy de Cauzé (1138-1142). Vers 1142
ce dernier accorda à l'abbaye le lieu de Merlande, où Élie Audoin, second abbé de
Chancelade, s'empressa de faire construire une chapelle. [...] On ne construisit que la
partie dont le style est pur roman. En élevant cette construction et en y adjoignant des
bâtiments d'habitation et d'exploitation, l'abbé de Chancelade voulut-il en faire un centre
d'agriculture, ou encore un lieu de refuge destiné aux voyageurs ?
Quelques années plus tard, cette chapelle étant jugée trop exiguë, on résolut de l'agrandir
en lui accolant deux travées surmontées chacune d'une coupole. Mais les Anglais courant la
campagne aux environ de Périgueux, durent saccager Merlande, et il est probable qu'alors,
vers 1172, la première travée à coupole fut abattue.
³
"À peine cette église était achevée, que les revers vinrent l'assaillir.
Périgueux refusait de se soumettre à la domination anglaise. Le roi d'Angleterre
résolut d'en faire le siège. En 1172, ce prince, accompagné de ses deux fils,
Henri-le-jeune et Richard, duc d'Aquitaine, d'Alphonse II, roi
d'Aragon, et d'Emmengarde, dame de Narbonne, se présenta devant le
Puy-Saint-Front, le point le plus fortifié de la ville. Repoussé vigoureusement, il se
vit contraint de lever le siège et de se retirer. Honteux de sa défaite, il s'en vengea
sur les environs de la ville, les couvents, les communautés, les églises, et Merlande
fut saccagé. Une partie de la nef fut détruite. Il ne resta debout qu'une coupole et le
sanctuaire."
²
"La reconstruction fut presque immédiate ; seulement, craignant quelques nouvelles dévastations,
les ressources manquant peut-être aussi, on prit le parti de remplacer la coupole abattue
par une voûte ogivale en berceau, qui recouvrit alors la travée démolie. [...] La porte d'entrée,
épargnée à hauteur de l'archivolte supérieure, fut reliée avec les nouvelles maçonneries."
³
|

|
|
"Les chapiteaux des colonnes supportant l'arc-doubleau attendaient des ornements
qui leur ont été refusés. À quoi tient cette circonstance ? Il serait difficile de le
dire. On manqua, sans doute, de sculpteurs pour ce travail, qui eût été postérieur aux
décorations nombreuses du sanctuaire."
¹
À moins que la construction des coupole n'ait malheureusement coïncidé avec l'arrivée
de Richard-Cœur-de-Lion et de ses troupes...
|
|

|
|
"Quatre fenêtres, extrêmement allongées, et semblable à des barbacanes, éclairent cette
église. [...] Elles sont évasées à l'intérieur et offrent partout le plein-cintre.
¹
Il semble que la restauration n'ait pas toujours respecté ces dimensions... Une
seule ouverture, visible sur la photo ci-dessus, pourrait correspondre à celles d'origine.
|
|
On remarquera la grande dalle centrale au-dessous de laquelle reposent 13 prieurs...
Elle se trouve à égale distance de la porte et du maître-autel, au pied de la balustrade
des autels latéraux... Elle est directement sous la clé de voûte de la coupole, et se trouve
ainsi au centre même de l'édifice.
"Au-dessus de la coupole bien conservée, était construite une tour qui, menaçant
ruine, fut abattue il y a à peine quarante ans [en fait, autour de 1850]
Nous n'avons pu que reconnaître ses soubassements bâtis sur les arcs-doubleaux et les murs
longitudinaux sur lesquels fut établie la coupole elle-même."
³
Ajoutons que, pendant sept cents ans, le clocher de l'église étant au-dessus de la coupole,
la corde de la cloche passant par la clé de voûte, le sonneur foulait ainsi la pierre des
prieurs décédés. Les religieux voulaient être humbles, jusque dans leur tombeau.
Il semble aussi que leurs mains, glacées par la mort, eussent voulu appeler encore au pied
des autels leur chrétienne population...
|

|

|
"Dans l'angle du mur qui sépare le chœur du sanctuaire, on remarque une grosse colonne
courte, dépourvue de chapiteaux, formant une espèce de tambour. C'est en elle qu'est placé
l'escalier pour arriver sur les voûtes."
¹
Cet escalier était fermé par une porte de bois placé dans cette sorte de tambour. L'escalier
était déjà en ruine en 1874. En 1945, lors de la restauration du site par les Monuments
Historiques, il a été tronqué et donne aujourd'hui sur une petite porte de bois située à
mi-hauteur du mur sud.
|

|

|

|
départ de l'escalier dans l'épaisseur du mur
|
|

arrivée sur la porte
(donnant sur le vide)
|

vue sur le chœur
|
|
"Ce monument fut bâti après la première croisade, à laquelle se trouvait Rainaud,
de Thiviers, évêque de Périgueux. L'ogive qui y règne avec le plein cintre
n'est qu'un vivant souvenir de cette religieuse expédition.
À l'époque de la construction de l'église de Merlande, les architectes avaient abandonné
le système des voûtes sphériques. Les voûtes étaient divisées par parties carrées, et les
arcades étaient croisées pour neutraliser la pression latérale, qui était divisée sur
quatre points opposés et correspondant à des piliers ou à des faisceaux de colonnes. La
présence des coupoles dans cette église n'est qu'une imitation des églises cathédrale et
collégiale de St-Etienne et de St-Front. Il est évident qu'on voulut prendre
pour modèle le style et le plan de ces deux églises. [...]
Ce genre d'architecture, déjà étranger au XIIème siècle, ne fut donc adopté, ce nous semble,
qu'avec une intention marquée de plaire au donateur du terrain. On crut ne pouvoir mieux
faire que de prendre sa cathédrale pour modèle. Le sentiment de la reconnaissance autorise
naturellement cette conjecture."
²
|
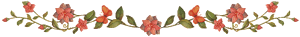
La porte du sanctuaire, autrefois surmontée de la "Poutre de Gloire",
probable ancienne entrée de la chapelle primitive...
Pour accéder au sanctuaire, trois niveaux à franchir... Et pour passer la porte,
trois marches...et une conversion symbolisée par les corps en torsion sculptés dans les
chapiteaux des deux piliers de l'entrée...
"On voit sur ces chapiteaux des lions, des tigres entrelacés, luttant ensemble et se
déchirant. Leur pose est admirable, et le sculpteur a su donner à ces animaux une expression
si vraie, qu'on est frappé de leur attitude et de l'air menaçant qu'elle inspire."
¹
"On est presque effrayé de leur air farouche, qui s'harmonise si bien avec la demi-obscurité
régnant dans la chapelle.
Au-dessus de cette porte, le mur s'élevait plein et enfin formait un fronton qui, lors des
adjonctions postérieures, fut rasé."
³
Dans le sanctuaire, ces animaux, du haut d'élégantes colonnettes formées d'un cylindre d'une
seule pièce, "diront" la création quand, de
leurs gueules ouvertes, s'épanchera la luxuriance du monde végétal... Ces chapiteaux sont,
en effet, "couverts de sculptures très variées. Les uns sont chargés de feuilles, d'entrelacs,
de torsades, de chevrons brisés, de billettes, et les autres de figures fantastiques, à la
bouche desquelles aboutissent les enroulements de diverses feuilles ou d'ornements variés."
¹
On ne peut s'empêcher de songer au mot de Maurice Zundel :
"Le sens même de l'univers est de refléter le visage de Dieu,
c'est de participer à son amour,
c'est d'entrer dans la jubilation de la Trinité divine."
|
| |
(les chapiteaux du sanctuaire, de gauche à droite)
|

sanctuaire côté EST
|
 > >
sanctuaire côté OUEST
|

|

|

| |
Treize arcades feintes décorent les murs du sanctuaire.
"Une colonne avec deux arcades ont disparu pour faire place à une fenêtre, la seule
aujourd'hui qui éclaire le sanctuaire. Primitivement, il en existait une dans le fond de
l'abside. Elle était semblable à celles qui éclairent la nef. Elle a été bouchée [...]
ainsi qu'un œil de bœuf construit beaucoup plus tard."
¹
L'ouverture, dans le fond de l'abside au-dessus de l'autel, a donc été modifiée.
À l'origine, haute et
très étroite à l'extérieur, elle s'ouvrait largement vers l'intérieure, à l'identique de la
seule fenêtre que l'on peut considérer comme d'origine et qui se situe à mi-hauteur
du mur nord dans la nef (voir photo plus haut). On l'a habillée d'un vitrail, certes
contemporain, mais artistiquement
travaillé et porteur d'un message fort, s'harmonisant parfaitement dans l'architecture
générale du bâtiment. Il s'agit d'une quintuple représentation en étages : trois épis de blé,
une colombe s'abreuvant, un poisson et une corbeille de pain, un agneau couché sur un
livre à 7 sceaux, et enfin un pellican rassasiant deux de ses petits... Une symbolique
à déchiffrer mais dont le sens transpire le verre...
|
|
"Au-dessous du sol de cet édifice, existe une voûte plein cintre, mi-taillée dans le roc,
qui nous a paru remonter à l'époque de la première construction. Serait-ce une crypte établie
sous la chapelle et dont quelques restes subsistent encore ?... Il se pourrait fort bien ; mais
nous pensons que plus tard elle eut une destination profane et servit de cellier aux
religieux du prieuré."
³
Mais il se trouve que la source, justement, jaillit en cet endroit !
Imprenable si l'on ne prend le bâtiment.
L'eau court dans cette crypte en y déposant
ses alluvions, pour ressortir à travers le mur, côté sud.
A quelques mètres de là, la commune de La Chapelle Gonaguet a fait constuire, en 1924,
un lavoir public sur un terrain qui, lui, était privé. Ceci déclencha, une soixantaine
d'années plus tard,
une querelle s'achevant au tribunal de grande instance de Bordeaux... Lequel confirma
le caractère privé du lieu. Ce lavoir fut enseveli. Il n'en reste aujourd'hui qu'un bac de
décantation en pierre de forme originale où convergent les eaux de la source.
Cette source fut protégée, au XVIème siècle, par un trou de tir rasant, comme il en fut
aménagé ailleurs, tout autour du prieuré. C'était au temps des guerres de religion...
|

|

|

|

|

| |
La source jaillit à l'angle des bâtiments. Elle est captée et canalisée jusqu'au réservoir
en pierre qui servait de filtre à l'entrée du lavoir, aujourd'hui disparu.
|
|
|
Une voûte en berceau plein cintre couvre le sanctuaire.
De la chambre forte, élevée au-dessus du sanctuaire, un judas permettait de suivre les
célébrations... À moins que ce ne soit un trou de tir aménagé au XVIème siècle et
protégeant l'autel, tel qu'il en a été créés bien d'autres, dont deux, l'un à côté de l'autre,
à la base de la coupole et protégeant la porte d'entrée de la chapelle...
|

|


Trous de tir de la voûte, vue de l'extérieur et vue de l'intérieur
|
Car Merlande, balafrée presque dès sa naissance par l'Anglais, dut encore souffrir par
la sauvagerie des hommes...
"Plus tard, au XVIème siècle, Merlande se trouva mêlé à des luttes religieuses qui lui
attirèrent de nouveaux revers et lui valurent encore des ruines."
³
"Sous l'administration de l'abbé François de Brianson, l'abbaye de Chancelade
fut ruinée deux fois par les protestants : la première fois, dans le mois d'Août 1575 ;
la seconde fois, le 15 juillet 1585.
Les religieux de cette abbaye se réfugièrent-ils dans l'église de Merlande, ou bien leurs
ennemis s'en emparèrent-ils ? Les documents écrits nous manquent pour décider clairement
la question. Mais il est un fait incontestable que le monument lui-même nous révèle.
Il est certain qu'il fut occupé par des gens de guerre ou armés pour se défendre, et
qu'il devint un objet de lutte acharnée. Tout le démontre : un surhaussement considérable
des murs, de nombreuses meurtrières dans la partie exhaussée, un corps-de-garde établi
sur le sanctuaire, une tour avec des mâchicoulis, construite dans l'angle du mur, vers
le nord, des fossés et des postes fortifiés.
Ces travaux sont évidemment du XVIème siècle et portent le cachet de la plus grande
précipitation : murs exhaussés en moëllon ; les meurtrières sont faites avec du bois
et, les ouvertures pratiquées dans les voûtes pour assaillir les gens qui auraient voulu
pénétrer dans l'église sont informes."
²
|
"Nous n'avons plus, à cette époque,
de murs construits en pierre de taille de Chancelade ; la nécessité forçait à employer le
moellon brut qui se trouve à profusion aux environ de la chapelle. Une tour avec mâchicoulis
fut construite à l'angle nord du bâtiment primitif, et une pièce, assurément, fut établie
au-dessus de la chapelle romane : elle a servi de logement aux défenseurs.
À cette pièce, on communiqua par un escalier crénelé, bâti extérieurement sur le flanc
de la façade latérale du sud.
[peu reconnaissable sur la photo ci-dessus, semble un
plan incliné gris entre la toiture à gauche et le mur de la chapelle]
Au droit de la porte d'entrée, au-dessus de la chapelle romane et dans l'arc doubleau de la
travée à coupole, furent percées des meurtrières plongeant dans les premières travées de la
chapelle et les commandant. Dans le mur de façade, orienté vers l'ouest, les traces de
meurtrières existent encore, et plusieurs parties des murs gouttereaux sont restaurés en
blocaille, signe évident de dégâts réparés avec la plus grande hâte."
³
|

|

L'entrée de la tour, au-dessus du sanctuaire (salle des gardes)
‹— L'escalier intérieur permettant d'accéder à la salle des gardes
|
|

|
|
"Des défenses extérieures furent également construites ; des fossés, entourant toutes les
constructions, subsistent encore, commandés par quelques ouvrages avancés.
Des cloîtres, aujourd'hui rasés, mais dont quelques amorces indiquent encore l'emplacement
et la direction, étaient bâtis au nord et au sud de la chapelle.
Sur le mur longitudinal, du côté nord, des traces de toits, et, espacés régulièrement,
des trous ayant reçus les abouts de poutrelles d'un plancher, indiquent de la façon la plus
évidente que des bâtiments d'habitation y étaient appuyés."
³
|
|
|
|
"Le cimetière, en avant de la porte principale, était clos de murs dans lesquels des meurtrières,
visibles encore aujourd'hui, furent ménagées. Il formait un ouvrage avancé commandant
cette porte et destiné à en battre les abords. Du reste, sa position sur un tertre l'indique
suffisamment.
[...]
Toutes les constructions dont nous venons de parler subsistèrent jusqu'en 1789, telles
qu'elles avaient été complétées au XVIème siècle. Cette date est funeste pour le prieuré de
Merlande, et c'est à peine si, grâce à quelques esprits éclairés, il a pu, depuis, ne point
complètement être enseveli sous ses ruines."
³
|

|
|
"À cette époque, le dernier prieur, obligé
de fuir pour échapper aux poursuites dirigées contre lui, se noya dans les fossés de son
prieuré. Son portrait, conservé dans la tour qui existe encore, se voyait il y a quelques
années. Il a aujourd'hui disparu. Ces quelques détails sont toujours présents à l'esprit
des habitants de Merlande, qui ont bien voulu nous raconter l'évènement. Tout fut pillé,
saccagé, détruit de fond en comble ; la chapelle seule fut épargnée ! Qui retint alors
l'aveuglement de ces barbares ? Nul ne le sait !... Les bâtiments d'habitation et
d'exploitation furent complètement rasés, et peu s'en fallut, sans doute, que tout ne
fut détruit."
³
|

|
M. MIALLION fut nommé commissaire délégué par la commune de Merlande pour la vente
des appartenances du prieuré de Merlande, présidant aux adjudications faites à la Révolution.
Comme de coutume, son nom fut gravé dans la pierre...
|
|
"La tourmente passée, et lors du concordat de 1801, Merlande fut déclassé, fondu dans
la commune de La Chapelle Gonaguet, et la chapelle abandonnée nue et sans couverture
aux intempéries des saisons.
Les constructions primitives n'en souffrirent point, car, aujourd'hui encore, elles ont tout
autant de solidité qu'à leur origine. Toutefois, les constructions du XVIème siècle modifiant
tout l'édifice et ayant subi quelques tassements, on craignit une destruction prochaine et
totale de cet édifice que les arts ont tant d'intérêt à conserver.
Mais une fois encore la chapelle fut sauvée ! M. l'abbé Audierne, dont on ne saurait trop
louer l'initiative, obtint de M. le ministre de l'intérieur qu'elle fût classée au nombre des
monuments historiques. Cette distinction lui valut quelques crédits qui permirent de la
recouvrir entièrement d'une charpente nouvelle.
³
En effet, la municipalité de la commune manquant de ressources pour l'entretenir et redoutant
les accidents, tant l'état de délabrement était critique en ce milieu du XIXème siècle,
avait décidé la démolition partielle du bâtiment !
Voici ce qu'écrit l'abbé Audierne, en 1847, en guise de rapport d'inspection qui
déboucha sur le renoncement du maire de La Chapelle Gonaguet à démolir l'église et sur
l'obtention de fonds pour sa restauration auprès du ministre de l'intérieur de l'époque,
au titre des monuments historiques :
|
|
"L'église primitive est construite toute entière en pierre de taille. Nulle lézarde ne
se manifeste dans cette construction. Les murs sont aussi solides qu'ils l'ont jamais été.
Ils étaient peu élevés, comme l'annonce la corniche du sanctuaire, et dominés par les
coupoles apparentes. Mais l'exhaussement des murs mal construits n'a pu résister à l'intempérie
des saisons et à l'action meurtrière du temps. Ces murs du XVIème siècle se sont entr'ouverts
dans plusieurs endroits et offrent peu de sécurité. Un mur bâti sur un arc-doubleau, pour
supporter un clocher, augmente le danger ; et la toiture, la charpente, abandonnées à
elles-mêmes depuis plus d'un demi-siècle, se dégradant journellement et favorisant
l'infiltration des eaux dans les murs et dans les voûtes, finiront par amener la ruine
d'un monument que l'art tient à conserver. [...]
Pour restaurer l'église de Merlande, deux moyens se présentent : le premier est de réparer
la toiture, remplacer les mauvais bois de la charpente, reboucher les brèches, refaire
les parties lézardées, démolir le mur qui charge l'arc-doubleau et rétablir ailleurs
le clocher qui pèse aujourd'hui sur les voûtes et en compromet la solidité.
Le second moyen serait d'abattre les murs exhaussés, pour remettre l'église dans sa forme
primitive. Alors la toiture serait basse et la coupole saillante. Ce dernier mode de
restauration serait le plus convenable sous tous les rapports, puisqu'il rétablirait
l'église telle qu'elle était d'abord. Mais il exigerait beaucoup plus de dépenses, et ce
n'est que pour cette raison que M. l'architecte du département, qui nous accompagnait dans
notre visite de l'église de Merlande, y a renoncé pour adopter le premier mode, plus économique
et plus prompt. [...]
M. Seguy, maire de La Chapelle Gonaguet, dont la loyauté n'est pas moins grande
que la bonté, et qui voulut bien nous accompagner dans notre inspection de l'église de
Merlande, frappé de nos réflexions, reconnut l'importance de cette église, et se désista de la
demande qu'il avait faite d'en abattre une partie.
Tout militait donc en faveur de cette église. Ainsi M. le ministre de l'intérieur a daigné
la classer au nombre des monuments historiques, en accordant les fonds nécessaires pour sa
restauration.
Grâce à cette bienveillance détermination, nous comptons un monument de plus, et les arts
et la religion s'en applaudissent."
²
|
|
Les fonds ont bien été débloqués et le prieuré sauvé d'un effondrement certain, mais ce ne
sera qu'en 1892 que le conseil municipal de La Chapelle Gonaguet obtiendra
le classement de l'ancien prieuré aux monuments historiques, par décret du 3 août 1892.
Et c'est donc au milieu du XIXème siècle qu'a été démoli le clocher qui dominait la voûte
en coupole.
|
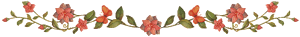
|
VISITE DES COMBLES
|

Au-dessus du sanctuaire
|

Au-dessus de la voûte d'entrée
|

Au-dessus de la voûte en coupole
On remarque, au faîte, le tronc creux par lequel passait la corde de la cloche.
|

Vue plongeante sur le chœur, à travers ce tronc.
|
|

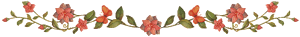
"Merlande est une des églises les plus remarquables du Périgord. Tous les caractères de
l'époque où elle a été construite semblent dessinés sur chaque pierre. Le chœur en
est petit comparativement à la nef. Cette église est sans collatéraux ; elle n'est décorée
par aucune chapelle, et sa forme n'est pas une croix latine. Elle a tout l'aspect des
temples primitifs. On ne la dirait point érigée dans le XIIème siècle. Sa physionomie est
dure, sévère : en elle règne absolument l'ancien style roman avec son étonnante lourdeur.
Malgré que l'ogive se montre dans quelques parties de ce monument, et qu'à cette époque
ce genre d'agriculture fût déjà assez communément employé, cependant elle n'a influé en
rien sur l'ensemble de l'édifice. Les colonnes sont ornées de filets ; mais elles sont courtes
et sans grâce. Les chapiteaux sont couverts d'ornements contournés, riches, mais manquant de
cette élégance, de cette légèreté qui distinguent les ordres antiques ou les chef-d'œuvre
de la renaissance."
¹
La chapelle est ouverte tous les jours à la visite et à la prière.
Pour des raisons de sécurité, ni les combles, ni la crypte ne se visitent ; ni bien sûr, le
logis des prieurs, propriété privée.
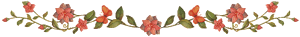
¹
Annales agricoles et littéraire de la Dordogne - 1846 - par l'abbé AUDIERNE
²
Annales agricoles et littéraire de la Dordogne - 1847 - par l'abbé AUDIERNE
(rapport d'inspection de l'église de Merlande en vue du classement aux
Monuments Historiques et de sa réfection)
³
Notice historique et descriptive de 1874 - Société Historique et
Archéologique du Périgord - tome 1 - 3ème livre
4
M. Paul RIBOULET, artisan-maître ébéniste qui a connu Merlande depuis 1918, dans une lettre
au Maire de la Chapelle Gonaguet datée de 1987...
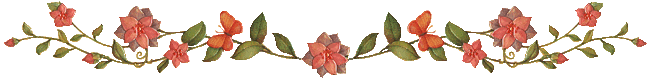
|
pour revenir au menu, réduire ou fermer la page
|
|

